La phagocytose est en fait le mode "ancestral" d'alimentation des êtres vivants unicellulaires. Il a été conservé chez certaines cellules spécialisées des organismes pluricellulaires - cellules qui d'ailleurs sont libres de leurs mouvements et vivent donc "comme leurs ancêtres". Les phagocytes (cellules qui font la phagocytose) sont les leucocytes (macrophages et polynucléaires) et les cellules dendritiques.
7) Étapes de la phagocytose - 1 point(s)
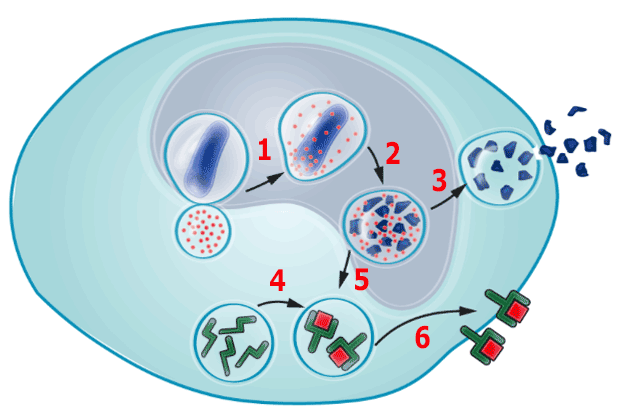
| 1 | fusion de la vésicule contenant le microbe avec une vésicule d'enzymes digestives |
|---|---|
| 2 | digestion du microbe |
| 3 | élimination des déchets de la digestion du microbe |
| 4 | formation des molécules CMH par association de deux sous-unités |
| 5 | association des molécules CMH avec des éléments provenant du microbe (des antigènes) |
| 6 | présentation à la surface de la membrane des antigènes du microbe dans les "corbeilles" du CMH |
8) Les cellules présentatrices d’antigènes - 1 point(s)
présentent des antigènes qu'elles ont captées sur les macrophages |
|
présentent des antigènes qui proviennent des microbes qu'elles ont phagocytés |
|
se regroupent sur le site de l'infection |
|
présentent des antigènes en utilisant les molécules du CMH |
Les antigènes (Ag) présents à la surface d'une cellule proviennent des microbes que cette cellule a phagogytés (ou alors c'est une cellule infectée par un virus par exemple). Ces Ag sont présentés dans une "corbeille" faite par les molécules du CMH. Les CPA migrent et se regroupent dans un organe lymphoïde secondaire.
9) Les organes lymphoïdes secondaires - 1 point(s)
sont des cellules immunitaires |
|
sont situés le long des trajets des vaisseaux lymphatiques |
|
comprennent le thymus et la moelle osseuse |
|
sont le lieu de migration des CPA après leur activation par les antigènes de l'agent infectieux |
Un organe est constitué de (tissus formés de) cellules. Le thymus et la moelle osseuse sont des organes lymphoïdes primaires, c'est-à-dire là où se fait la maturation des cellules immunitaires (voir immunité adaptative).
10) Les médicaments anti-inflammatoires - 1 point(s)
facilitent la réaction de défense de l'organisme en diminuant l'inflammation |
|
agissent directement sur les médiateurs chimiques de l’inflammation |
|
diminuent la fabrication de certains médiateurs chimiques de l’inflammation |
|
permettent d'éviter une infection |
Les médicaments anti-inflammatoires ont pour effet de diminuer la quantité de médiateurs chimiques de l’inflammation et donc d'atténuer les symptômes de celle-ci : on a moins mal et la zone infectée est moins rouge, moins gonflée et moins chaude. Cependant, ces médicaments n'ont pas d'action contre les agents infectieux qu'il faut continuer de combattre (désinfection, etc.).